Banane, Musa spp.
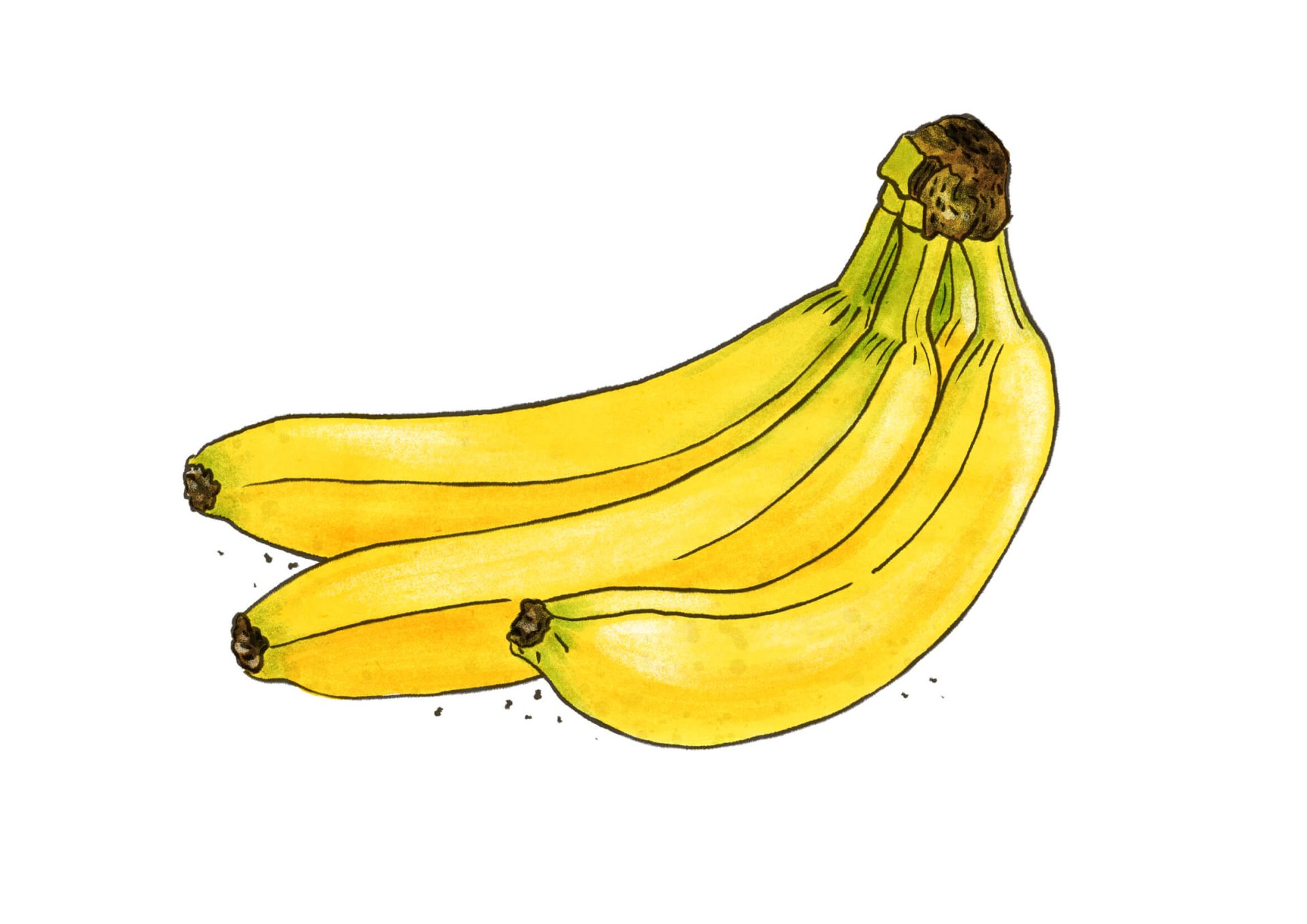
Superficie globale : 12,8 millions d’hectars, dont 54% de bananes plantin
Superficie au Champ du Monde : 16,2 m² (0,8%)
Région d’origine : Asie du Sud-Est
Principale région de production : Ouganda, Congo, Inde
Principales utilisations : à cuisiner ou comme fruit
Les bananes sont les fruits qui sont le plus exportés au monde, avec un volume de transactions d’environ 10 milliards de dollars américains par an. Il s’agit d’une importante source de revenus pour des milliers de foyers ruraux dans le Sud global. La forte dépendance aux produits agrochimiques dans la production et les prix en baisses pour les producteurs en ont fait de graves problèmes écologiques et sociaux.
Une baie des tropiques
La banane est une plante herbacée vivace qui peut atteindre six mètres de haut. Elle ne forme pas de tronc, mais un pseudotronc constitué de gaines foliaires étroitement enroulées. Ses grandes feuilles coriaces poussent en spirale, tandis que les fruits pendent en grandes grappes sur la plante. D’un point de vue botanique, la banane est une baie. La plante a besoin d’un climat tropical avec des précipitations régulières et est extrêmement productive. Elle se multiplie à la fois par graines et par voie végétative via des pousses qui jaillissent directement du système racinaire de la plante mère.
Alors qu’il existe dans le monde plus de 1 000 espèces de bananes, la banane de Cavendish en particulier s’est imposée sur le marché et se trouve sur les étals de fruits de nombreux supermarchés. Pourtant il existe une variété impressionnante de couleurs, de formes et de textures, qui donnent des bananes du rouge au bleu, des petites ou des grandes, plus ou moins sucrées… Cette diversité est souvent ignorée, car le commerce international se concentre principalement sur cette sorte de banane.
Aliment de base et reine de l’export
La banane provient à l’origine d’Asie du Sud-Est et a été cultivée depuis plus de 7 000 ans. Les marchands l’ont introduite en Afrique et dans les régions tropicales d’Amérique. L’Inde est aujourd’hui le plus grand producteur de banane douce, et c’est en Ouganda et au Congo que sont cultivés le plus de bananes plantins. Dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, la banane plantin constitue un important aliment de base. Cependant le marché de l’exportation est dominé par des pays d’Amérique latine tels que l’Équateur et le Brésil. La production s’effectue en grande partie dans des monocultures, en particulier dans des plantations de grande surface orientés vers l’export à l’international. Parallèlement, la banane joue un rôle important en tant que plante nourricière locale dans beaucoup de pays tropicaux où elle y pousse dans de nombreux jardins.
La polyvalence optimale
Les bananes sont riches en nutriments tels que le potassium, la vitamine C et les fibres. Elles favorisent la santé cardiaque, contribuent à réguler la pression artérielle et constituent une source d’énergie facile à digérer. De plus, en raison de leur faible teneur en matières grasses et de leur haute densité nutritionnelle, les bananes sont très appréciées des sportifs et des personnes souffrant de troubles digestifs. Sur le plan culinaire, elles offrent une multitude d’utilisations : elles peuvent être consommées fraîches ou utilisées dans la préparation de smoothies, de desserts et de pâtisseries. Dans de nombreux pays tropicaux, les bananes plantains sont cuites, frites ou cuites au four et constituent un aliment de base riche en amidon. Elles peuvent être dégustées sous forme de purée, comme dans le plat mangú, un petit-déjeuner typique de la République dominicaine. En Asie et en Amérique latine, les bananes plantains sont également consommées dans les currys, tandis qu’en Afrique, elles sont frites, ajoutées aux soupes et aux ragoûts ou consommées sous forme de fufu. Les possibilités culinaires sont nombreuses et variées : un voyage à la découverte des plats à base de bananes plantains vaut vraiment le détour.
D’ailleurs : les feuilles des régimes de banane sont utilisées comme mode d’emballage et d’assiette.
Comment la maladie du Panama a changé la concommation mondiale de bananes ?
Jusque dans les années 1950, la Gros Michel était la variété de banane dominante, avant d’être presque entièrement décimée par la maladie de Panama (race tropicale 1). Afin d’assurer l’approvisionnement, la banane Cavendish, plus résistante, a été introduite dans le monde entier. Elle reste aujourd’hui encore la variété de banane la plus courante sur le marché mondial. Cependant, l’arôme artificiel bien connu de la banane provient toujours de l’ancienne Gros Michel et diffère donc du goût de la banane Cavendish actuelle. Ironiquement, la Cavendish est aujourd’hui confrontée à une menace similaire : la race tropicale 4 (TR4), une variante plus agressive du même champignon, se propage et met en danger les stocks mondiaux de bananes. Comme de nombreuses plantations sont exploitées en monoculture, ces maladies se propagent rapidement et peuvent entraîner des pertes de récoltes. Les pauses dans la culture, les cultures mixtes et la rotation des cultures peuvent contrer la propagation du champignon.
Les plantations de bananes : lieux d’exploitation
Dans beaucoup de plantations de bananes dans de nombreux pays ont lieu de graves atteintes aux droits des travailleurs : beaucoup de personnes travaillant dans le secteur de l’agriculture sont mal payés et exposées à des risques sanitaires en raison de l’utilisation de pesticides. En 2010, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage a qualifié les conditions de travail dans les plantations de bananes en Équateur de « comparables à l’esclavage ».
Depuis les années 1950, l’Équateur est le plus grand exportateur mondial de bananes. Près d’un tiers des bananes commercialisées sur le marché mondial proviennent de ce pays. L’Équateur compte environ 5 000 producteurs de bananes, allant des plus petites exploitations familiales aux grands producteurs. Les bananes sont généralement vendues à des intermédiaires, qui les revendent ensuite à des entreprises internationales telles que Chiquita ou Dole. Ces grands acteurs ne possèdent eux-mêmes pratiquement pas de plantations et dictent les conditions du marché aux intermédiaires, qui les imposent à leur tour aux producteurs de bananes. Les petits producteurs et les ouvriers agricoles en font les frais : ils sont exploités et ne peuvent guère se défendre contre les violations des droits humains, le travail des enfants et les salaires inférieurs au salaire minimum. La pulvérisation de pesticides hautement toxiques est également un problème grave : selon l’Oxfam, les grands producteurs de bananes effectuent en moyenne 40 cycles de pulvérisation par an. Des substances hautement toxiques, interdites depuis longtemps dans l’UE, sont pulvérisées à grande échelle depuis les airs. Cela représente un risque pour la santé des ouvriers agricoles, qui doivent souvent retourner dans les plantations après seulement quelques heures, ainsi que pour les riverains, car les distances minimales par rapport aux zones habitées ne sont souvent pas respectées.
Le long chemin de la banane
Afin que les consommateurs du monde entier puissent acheter des bananes mûres à tout moment, celles-ci sont récoltées lorsqu’elles sont encore complètement vertes. Elles sont ensuite transportées dans des conteneurs réfrigérés où le processus de maturation est stoppé. Elles sont transportées vers leur pays de destination dans des navires frigorifiques, où elles sont mises à mûrir dans des chambres de maturation grâce à un gazage ciblé et à une augmentation de la température, ce qui prend quatre à huit jours. Les bananes sont ensuite acheminées par camion vers les supermarchés, où elles sont mises en vente dans la couleur souhaitée, jaune ou encore légèrement verte. Derrière la banane « quotidienne » que nous trouvons au supermarché se cache donc un processus très complexe qui nécessite une grande quantité d’énergie et de ressources. Si elle n’est pas cultivée localement, la banane doit donc être consommée avec modération et son origine et sa variété doivent être choisies avec soin.
Contre la perte de la biodiversité
La culture à grande échelle de bananes en monoculture contribue considérablement à la perte de biodiversité. Selon la FAO, l’agriculture est responsable de 70 % de la perte mondiale de biodiversité, en particulier dans les pays du Sud. Les monocultures, telles que la culture de la banane au Costa Rica et en République dominicaine, entraînent l’érosion des sols, la pénurie d’eau et la pollution de l’environnement. L’exploitation intensive des terres détruit les habitats et menace de nombreuses espèces animales et végétales. Le projet « Del Campo ogl Plato » a soutenu des initiatives favorables à la biodiversité au Costa Rica et en République dominicaine, qui visent à rendre les plantations de bananes plus écologiques. Il s’agit notamment de la création de corridors biotopes, de l’utilisation de fibres naturelles issues des tiges d’ananas et de l’utilisation de micro-organismes pour améliorer la qualité des sols. L’utilisation innovante de l’humus de vers de terre et de la technologie des drones pour réduire la consommation d’eau et garantir des rendements à long terme est particulièrement impressionnante. Ces mesures montrent comment la biodiversité et l’agriculture peuvent être conciliées.
Sources
Klett. TERRA Geschichte Erdkunde Politik-Online : Infoblatt Banane.
Spektrum.de. Lexikon der Biologie : Bananengewächse.
Oxfam Deutschland : Edeka-Bananen aus dem Giftnebel.
Public Eye : Solange der Preis stimmt. Chiquitas Geschäfte in Ecuador und die Arbeitsbedingungen in den Plantagen.
Südwind. Institut für Ökonomie und Ökumene : Logistique et droits de l’homme : Ungleichheit im Bananen-Business. Lien.
Del Campo al Plato : Biotop-Korridore. Lien.
