Cocotier, Cocos nucifera
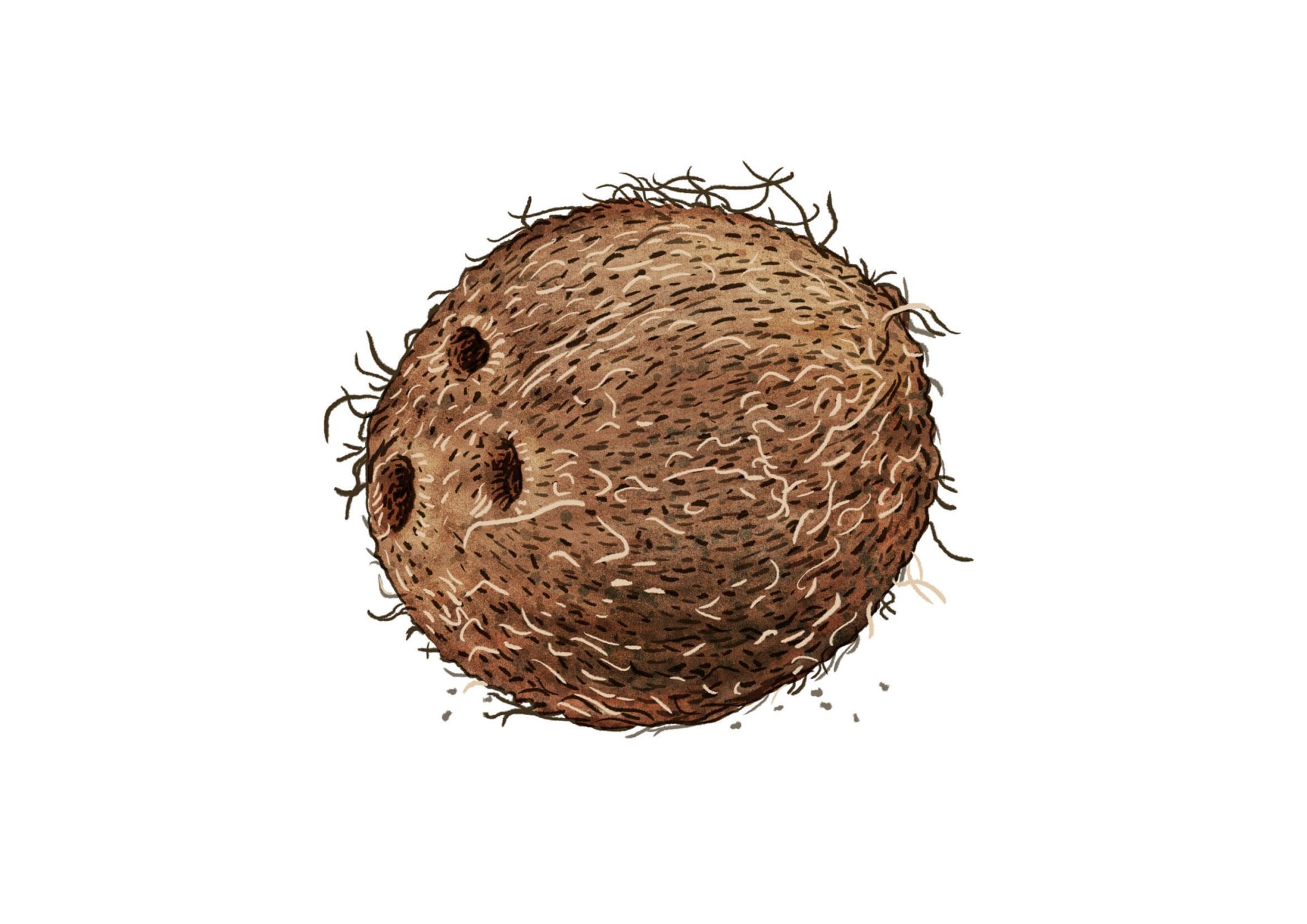
Superficie mondiale : 11,1 millions d’hectares – et zones illégales
Superficie au Champ du Monde : 14 m² (0,7 %)
Région d’origine : probablement la Mélanésie (archipel du Pacifique au large de l’Australie)
Principales zones de culture : Indonésie, Philippines, Inde
Principales utilisations : Alimentation, huile de coco
Le cocotier joue un rôle central dans les croyances de nombreux peuples. Par exemple, la noix de coco est un symbole très répandu de fertilité. Dans de nombreuses régions d’Asie du Sud-Est, d’Océanie et d’Afrique de l’Est, le cocotier, considéré comme l’arbre de vie, est considéré comme l’alter ego de l’homme, c’est-à-dire une plante avec laquelle il est lié par un destin particulièrement étroit. Les parents offrent à leur nouveau-né un plant de cocotier, qu’ils plantent dans la terre avec le placenta. Un proverbe indien dit que le cocotier a 999 usages et que le millième n’a pas encore été trouvé. En effet, toutes les parties de l’arbre, de la racine à la couronne, sont utilisées de diverses manières.
Jusqu’à quarante fruits par an
Le cocotier est une plante monoïque. D’un point de vue botanique, la noix de coco n’est pas une noix, mais une drupe comme la cerise ou la prune. Son enveloppe fibreuse est entourée d’un péricarpe extérieur coriace et correspond à la chair du fruit. L’enveloppe fine de la graine, la chair ferme qu’elle contient et l’eau de coco avec la plantule forment l’amande. Jusqu’à quarante fruits de la taille d’une tête mûrissent en moins d’un an dans la couronne d’un palmier qui peut atteindre jusqu’à trente mètres de haut. La sélection et les croisements ont permis de créer un grand nombre de variétés particulièrement productives et résistantes aux maladies et aux tempêtes tropicales.
Le cocotier pousse particulièrement bien dans la ceinture tropicale située entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, autour de l’équateur, jusqu’à une altitude de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, bien que son rendement diminue avec l’augmentation de l’altitude. Il nécessite des températures élevées et des précipitations tout au long de l’année, mais il est peu exigeant en ce qui concerne la fertilité du sol. Un seul cocotier produit entre 30 et 150 noix par an, en fonction de son âge, de son emplacement et des soins apportés. Cela correspond à environ dix à vingt kilos de coprah, la chair séchée du fruit à partir de laquelle on presse l’huile de coco ou on produit de la noix de coco râpée.
L’histoire de la noix de coco
Une noix de coco fossilisée trouvée dans le désert du nord-ouest de l’Inde a permis de supposer que la noix de coco était originaire du Gondwana occidental, un grand continent qui réunissait autrefois ce qui est aujourd’hui l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Australie, l’Inde et l’Antarctique. Lorsqu’il s’est disloqué il y a 200 à 130 millions d’années, l’espèce de palmier s’est développée sur les bandes côtières de la mer de Téthys. On pense que les noix de coco, capables de rester viables pendant des mois, se sont répandues en flottant sur la mer.
Il y a plus de mille ans, elles jouaient déjà un rôle important en tant que marchandise. Nous savons qu’en 912 après J.-C., des noix de coco ont été apportées des îles de la Sonde à la cour du calife de Mésopotamie. Au Moyen Âge, les pèlerins et les marchands arabes ont apporté le fruit en Europe. À la fin du XVIe siècle, les marins coloniaux portugais ont fait en sorte que des gobelets en noix de coco incrustés d’or ou d’argent entrent en possession de la noblesse et du clergé. Les avantages économiques du cocotier pour l’Europe ont été reconnus pour la première fois par les Espagnols, qui ont introduit sa culture aux Philippines dès le milieu du XVIIIe siècle. Une centaine d’années plus tard, les Hollandais ont fait de même à Ceylan. Au départ, la culture était destinée à la production de cordages avec les fibres des noix, puis l’huile a également été utilisée pour la production de savons et de bougies. Vers la fin du XIXe siècle, des chimistes français ont réussi à utiliser l’huile de coco pour produire de la margarine, un substitut végétal du beurre. Par la suite, les terres consacrées à la production de noix de coco ont augmenté dans les pays producteurs et les quantités exportées d’huile de coco et de coprah se sont accrues régulièrement.
Aujourd’hui, le cocotier est de plus en plus en concurrence avec le palmier à huile, le tournesol, le colza et le soja en tant que source d’huile pour l’industrie du nettoyage et de l’alimentation. De nombreux pays producteurs s’efforcent désormais de fabriquer des produits finis et semi-finis à base de noix de coco dans leur propre pays et de traiter les sous-produits tels que le bois des palmiers retraités et âgés, l’eau de coco et les coques.
Selon la FAO, la superficie consacrée à sa culture a plus que doublé entre 1961 et 2014, passant de 5,2 millions d’hectares à environ 12 millions d’hectares. Depuis lors, la superficie a stagné, voire légèrement diminué, mais avec un rendement plus élevé. En 2022, près de 62,5 millions de tonnes de noix de coco ont été récoltées dans le monde, dont les trois quarts provenaient des trois plus grands producteurs que sont l’Indonésie, les Philippines et l’Inde. D’autres pays producteurs tels que le Sri Lanka, le Viêt Nam, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Thaïlande suivent de loin. Toutefois, la superficie cultivée dans le monde est probablement beaucoup plus élevée, car la culture est dominée par de petits exploitants dans le cadre d’une utilisation mixte, par exemple l’agroforesterie, et une grande partie de la récolte est consommée localement et n’est donc pas enregistrée dans les statistiques commerciales. Les principaux importateurs d’huile de coco sont les pays de l’UE, les États-Unis et la Malaisie.
Fruits, huile, outils, médicaments – utilisations diverses
Traditionnellement, l’huile de coco est principalement utilisée pour la friture dans les régions tropicales. Dans certains endroits, une noix de coco mûre peut être si sucrée qu’elle convient pour sucrer les aliments, tandis que dans d’autres régions, elle peut avoir un goût plutôt salé. L’eau des noix de coco âgées d’environ huit mois est encore aujourd’hui une boisson rafraîchissante très appréciée. L’alcool ou le vinaigre de coco est également produit à partir de l’eau de coco mélangée à du sucre selon différents procédés. Une spécialité des Philippines, de l’Inde et du Sri Lanka est le dessert « nata de coco », un aliment gélatineux qui est utilisé pur sous forme confite ou comme base pour des desserts et des boissons en conserve. Toutefois, comme l’huile de coco est généralement beaucoup plus chère que l’huile de palme dans ces pays, la consommation d’huile de palme augmente localement, tandis que de plus en plus d’huile de coco est exportée vers des pays étrangers riches.
En raison de sa forme naturelle, la coque de la noix de coco était un récipient ménager idéal qui était et est toujours utilisé sous les tropiques pour la nourriture, les boissons, l’huile de lampe et bien d’autres choses encore. La coque dure convient également à la fabrication de cuillères, de couteaux ou de tamis. La noix de coco creuse était utilisée comme résonateur naturel pour les instruments de musique (hochets, flûtes). Elle était également utilisée pour fabriquer des ceintures, des colliers et d’autres bijoux. La noix était également utilisée dans la médecine traditionnelle, par exemple sous forme de cendres pour traiter les maladies de peau, les rhumatismes, les maux de tête et les douleurs d’estomac. Depuis que la preuve scientifique de la stérilité de l’eau de coco a été apportée dans les années 1950, la médecine occidentale l’utilise en infusion et comme remède à la déshydratation en cas de diarrhée persistante.
Enfin, la coque de la noix de coco est un excellent combustible qui produit beaucoup de chaleur mais presque pas de fumée. Le charbon de bois obtenu sous forme de poudre était utilisé comme dentifrice et comme colorant dans les tropiques. Dans les pays occidentaux, il est utilisé comme charbon de barbecue et, sous forme de charbon actif, il entre dans la composition d’agents décolorants et désodorisants. La poudre obtenue à partir de la coque entre dans la composition d’adhésifs synthétiques et de nombreux articles en plastique. En Inde, la coque résistante a récemment été utilisée à titre expérimental dans la fabrication de blocs de béton.
L’huile de coco, un véritable superaliment ?
Depuis peu, des organisations et des entreprises intéressées et engagées dans la politique de développement s’efforcent de promouvoir la culture et la vente de la matière première renouvelable qu’est l’huile de coco. Cette promotion se fait dans l’esprit du commerce équitable et d’un développement durable, orienté vers l’avenir, afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la majorité des petits producteurs dans les pays tropicaux producteurs.
Néanmoins, comme l’huile de palme, l’huile de coco est principalement constituée d’acides gras saturés, pouvant contenir jusqu’à 90 % de graisses saturées. Les acides gras saturés sont généralement considérés comme nocifs pour la santé, car ils entraînent une augmentation du taux de cholestérol LDL et sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Bien que la communauté scientifique adopte aujourd’hui un point de vue plus nuancé à ce sujet, la publicité pour la noix de coco en tant que « superaliment » supposé particulièrement sain ne repose toujours pas sur une base scientifique solide.
De nombreux pays ne dépendent pas de l’huile de coco (ou de palme) provenant des tropiques, car ils disposent de suffisamment de plantes oléagineuses locales – en Europe, par exemple, l’olive, le colza et le tournesol. La culture locale nous évite non seulement de déboiser les forêts tropicales, mais aussi d’avoir recours à des méthodes de culture douteuses, à l’accaparement des terres et à de très mauvaises conditions de travail dans les pays producteurs. L’utilisation d’huiles locales permet également d’économiser des milliers de kilomètres de transport à travers le monde.
Les cocotiers sont-ils meilleurs que les palmiers à huile ?
L’huile ou les cocotiers ne sont ni mauvais ni bons. Le problème réside dans l’énorme demande d’huiles et de graisses végétales sur le marché mondial. Les énormes quantités nécessaires à l’industrie peuvent être produites à très bon marché dans des plantations industrielles en monoculture et dans des conditions de travail abusives.
Contrairement aux palmiers à huile, il n’y a pas eu d’expansion rapide et massive de la superficie consacrée à la culture de la noix de coco ; en fait, les chiffres ont stagné au cours des dix dernières années. En général, il n’y a pas autant de grandes plantations de cocotiers et d’entreprises internationales géantes que pour l’huile de palme. Les cocotiers sont également plus polyvalents, car toutes les parties de la plante peuvent être utilisées. Toutefois, cela ne signifie pas que c’est toujours le cas. Les plantations produisent d’énormes quantités de déchets de noix de coco, qui ne sont souvent pas utilisés du tout et ne sont pas non plus compostés correctement.
Sources
Spectre : Le cocotier, arbre aux mille possibilités. Lien.
Rettet den Regenwald e.V. : L’huile de coco n’est pas une bonne alternative à l’huile de palme. Lien.
WWF : Comme la glace au soleil : Huiles et graisses végétales dans les glaces. L’exemple de l’huile de coco. Lien.





